








La fondation Crédit Agricole Solidarité et Développement lance régulièrement des appels à projets en faveur de la santé dont la santé mentale des jeunes. Dans ce contexte, nous avons rencontré Marie-Rose Moro, pédopsychiatre et professeure de l’université Paris Cité. Elle dirige la maison de Solenn, la maison des adolescents de l’hôpital Cochin (AP-HP). Elle est aussi la cheffe de file actuelle de l’ethnopsychanalyse et de la psychiatrie transculturelle en France et en Europe.
La santé mentale a été désignée Grande Cause nationale en 2025. Pourquoi, à votre avis, s’intéresse-t-on particulièrement à la santé mentale aujourd’hui ?
Marie-Rose Moro. La santé mentale des enfants et des adolescents est un problème mondial de santé publique, aggravé bien avant la Covid. Chez cette population, elle est la première cause de mortalité et de morbidité. Les dépressions à l’adolescence et les idées suicidaires sont des problèmes majeurs, souvent associés à l’usage de substances comme l’alcool ou les drogues pour soulager la souffrance.
En France, une augmentation de la dégradation de la santé mentale est observée chez les préadolescents, particulièrement chez les filles. Les tentatives de suicide chez elles sont souvent moins prises au sérieux du fait qu’elles communiquent davantage. Pourtant, ce n’est pas parce qu’on en parle, que le risque de passage à l’acte n’existe pas. La dépression chez les adolescents peut se manifester différemment que chez les adultes, avec des changements rapides d’humeur et d’instabilité émotionnelle. Les changements de comportement, comme les modifications des envies ou de la manière d’être avec les parents, sont des indicateurs importants.
Les troubles anxieux sont également fréquents et peuvent se manifester par des symptômes corporels comme des maux de tête ou de ventre. En France, les « refus scolaires anxieux » et les troubles du comportement alimentaire (anorexie, boulimie) sont en augmentation, touchant même les filles et garçons prépubères. Les traumatismes sexuels, de plus en plus portés à notre connaissance, ont un impact psychologique terrible sur les enfants et les adolescents, nécessitant une reconnaissance et un traitement appropriés. Les questionnements de genre sont également en hausse, reflétant des questions existentielles plutôt que des pathologies.
Sur la question de l’accès de ces jeunes aux soins, où en sommes-nous ? Les choses avancent-elles dans le bon sens ?
M.-R. M. Globalement, en pédopsychiatrie, nous avons fait beaucoup de progrès, notamment dans les pathologies du trouble du comportement alimentaire. Aujourd’hui, nous associons la famille et organisons des thérapies familiales. La nouveauté aussi, c’est la thérapie multifamiliale, c’est-à-dire que nous associons plusieurs familles.
Cette année, nous observons 30 % de situations de crise supplémentaires. À la Maison de Solenn, nous accueillons 6 000 nouveaux ados par an, soit 10 000 au total si j’intègre ceux déjà suivis. Les listes d’attente s’allongent… Et les plus fragiles, ceux qui n’ont pas toujours accès à l’information, par exemple, sont les plus pénalisés.
S’il existe aujourd’hui des centres dédiés au diagnostic, ils n’assurent pas toujours les soins qui en découlent. C’est dramatique quand on sait que l’adolescence est une période fragile. Alors oui, nous avons conscience des faiblesses et les moyens pluridisciplinaires manquent, nous avons besoin de soignants, d’aides-soignants mais aussi d’artistes, d’enseignants, etc. Il nous faut plus de moyens, c’est fondamental car les soins d’aujourd’hui sont de la prévention pour demain.

« La santé mentale des enfants et des adolescents est un problème mondial de santé publique. Chez cette population, elle est la première cause de mortalité et de morbidité. »
Vos recherches vous ont mené à théoriser la vulnérabilité et les besoins spécifiques des enfants de migrants. S’en est suivie la création d’unités de soins dédiées. En quoi cette approche est-elle fondamentale ?
M.-R. M. J’ai développé un premier dispositif transculturel (lire encadré) à la fin des années 1990, à l’hôpital Avicenne (Bobigny), en banlieue parisienne, puis je l’ai développé ici à la maison des adolescents en 2008, au cœur de Paris. Cela a été important pour moi parce que je refuse l’idée que les dispositifs transculturels doivent se développer uniquement dans les lieux où arrivent les migrants et dans les zones où ils vivent. La migration est au cœur de nos sociétés. La psychiatrie transculturelle, c’est une psychiatrie contemporaine que tout le monde doit pratiquer étant donné la constitution de notre société et ses métissages. Malgré leur naissance en France, les enfants de migrants portent en eux une grande vulnérabilité. Pourtant, ils sont Français et ils deviendront des acteurs de la société française. Cette vulnérabilité est due au poids de l’immigration et des discriminations. L’enjeu, c’est de réussir à ce qu’ils s’approprient cette double culture qui est une richesse, un potentiel d’émancipation.
Pourquoi vous êtes-vous intéressée particulièrement aux origines, à l’héritage familial ? Dans une interview, vous évoquiez le fait qu’il y a en chacun de nous une pépite qui sommeille. Cette croyance, d’où vient-elle ?
M.-R. M. Elle vient de ma grand-mère Carlota, une Espagnole qui vivait en Castille. C’était une originale, qui ne savait ni lire, ni écrire mais qui adorait le cinéma et qui se nourrissait des films, des personnages, c’est ce qui l’animait. Un jour, je devais avoir 8 ou 9 ans, elle m’a dit qu’il fallait nourrir nos « ilusión », un mot espagnol dont la traduction en français se rapproche du mot « rêve » ou « espoir ». Elle disait qu’il fallait aller chercher ces rêves tapis en chacun de nous. Trouver sa pépite intérieure et aider les autres à trouver la leur. C’est ce que j’ai décidé de faire de ma vie.
La fondation Crédit Agricole Solidarité et Développement soutient chaque année des initiatives en faveur de la santé des jeunes. Quel regard portez-vous sur cet engagement de la part d’une banque ?
M.-R. M. Tous les engagements sont nécessaires, c’est une question de société ! La pédopsychiatrie, c’est l’affaire de tous. L’un de mes maîtres, le pédiatre et psychanalyste anglais Donald Winnicot, qui a beaucoup travaillé pendant la Seconde Guerre mondiale sur les effets de la guerre sur les enfants et les adolescents, disait qu’il fallait que la société s’empare de la protection des enfants. Je crois à cela aussi car si l’on veut faire de la prévention primaire, il faut que chacun des acteurs s’engage et soutienne ceux qui sont formés pour le faire et que l’on augmente le savoir de la société sur la protection des enfants.
| Psychiatrie transculturelle et/ou ethnopsychanalyse, de quoi s’agit-il ? « En France, on parle d’ethnopsychanalyse et dans le monde, on préfère parler de psychiatrie transculturelle. Je préfère utiliser ce terme pour intégrer les préoccupations internationales sur ces questions. Lors des échanges que l’on a avec l’enfant et sa famille, nous intégrons nos différences culturelles, cela permet de bien se rencontrer et d’être efficace. Nous ne parlons pas la même langue, nous n’avons pas la même représentation de la famille, de la souffrance, de la douleur, etc. En psychiatrie transculturelle, on travaille avec des traducteurs, et parfois avec des médiateurs, parce qu’au-delà des mots, on a besoin de traduire des représentations différentes. Dans un monde très globalisé où beaucoup de langues sont parlées, il est important que cette approche soit intégrée dans nos consultations. Cette psychiatrie transculturelle considère que les familles sont expertes de ce qui leur arrive et l’on se doit d’intégrer cette expertise, qu’elle soit culturelle, sociale ou sociétale. Il s’agit là finalement d’une psychiatrie démocratique, humaniste et fraternelle. » |
Pour aller plus loin, écoutez notre Podcast
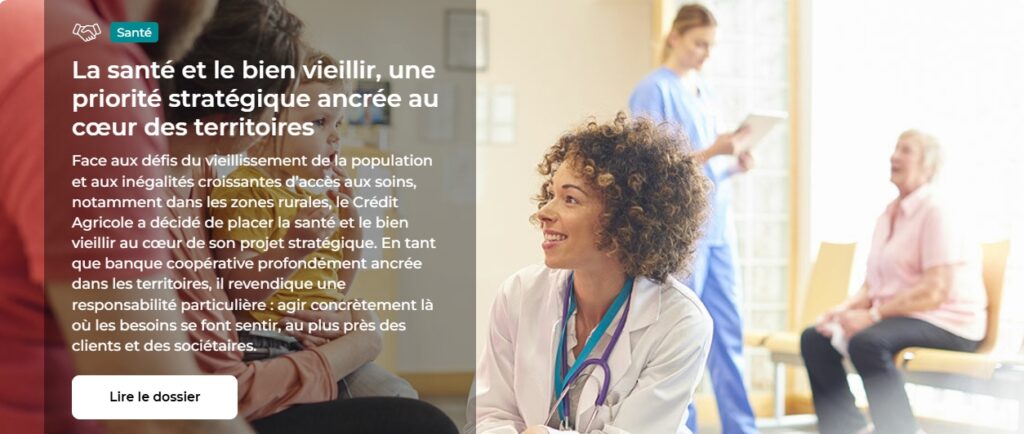
Instance politique du Crédit Agricole, la Fédération nationale du Crédit Agricole est une association loi 1901. Ses adhérents sont les Caisses régionales, représentées par leurs présidents et leurs directeurs généraux.
Mieux nous connaitre