Parler d’une crise de l’accès aux soins en France est devenu un lieu commun. Mais certains acteurs s’emploient concrètement à y répondre. C’est le cas d’Omedys, entreprise de télémédecine fondée par les médecins urgentistes Jérémie Goudour et Arnaud Devillard. Cette dernière connaît un développement rapide grâce à un partenariat inédit avec Crédit Agricole Santé et Territoires. Objectif : créer une alternative solide à la désertification médicale.
À la fin de l’année 2023, Crédit Agricole Santé et Territoires est entré majoritairement au capital d’Omedys, start-up troyenne créée par deux médecins urgentistes bien décidés à lutter contre la désertification médicale. Mais attention, précise d’emblée Jérémie Goudour, il ne s’agit pas d’un rachat classique : « Le Crédit Agricole ne rentre pas au capital des cabinets médicaux, qui restent des sociétés d’exercice libéral. C’est essentiel pour préserver l’indépendance des médecins et éviter la financiarisation de la santé. Il est entré au capital de la société qui organise le maillage territorial de notre solution. » L’ambition est claire : proposer une alternative à trois modèles aujourd’hui jugés insatisfaisants — le médecin isolé, l’hôpital public débordé et les plateformes télémédicales motivées avant tout par le rendement. « Ce qu’on propose, c’est un accompagnement de terrain, local, structuré, mais à taille humaine », explique l’un des deux fondateurs.
Un développement rapide mais maîtrisé
La première mission, après l’entrée du Crédit Agricole au capital, a été de structurer les fonctions support de l’entreprise : « Avant, nous étions totalement intégrés chez notre premier investisseur, mais le Crédit Agricole a eu l’intelligence de ne pas vouloir nous absorber dans ses structures. Nous avons donc internalisé la RH, la finance, l’administration… ce qui a aussi impliqué des recrutements. » En parallèle, le déploiement national s’est accéléré. « En 2023, nous avions trois cabinets. Fin 2024, nous en comptons 11, chacun relié à une quarantaine de salles de téléconsultation réparties dans les territoires », détaille Jérémie Goudour. L’idée : ne pas installer des dispositifs en surplomb, mais bien s’inscrire dans la réalité des territoires, avec les Caisses régionales, les élus locaux, les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) et les professionnels de santé.
La Caisse régionale Champagne-Bourgogne, laboratoire de coopération
Parmi les territoires pilotes, Champagne-Bourgogne fait figure de référence. « C’est un territoire où la collaboration avec la Caisse régionale et le référent santé est exemplaire. C’est ce modèle de coopération fluide que nous cherchons à dupliquer ailleurs. » Le succès repose sur la connaissance fine des besoins locaux. « On est là pour compléter, pas pour remplacer. Ce n’est pas un modèle disruptif : on respecte l’ADN du territoire. » Mais cette réussite pose aussi des défis : « Aujourd’hui, on reçoit plus de demandes que ce qu’on peut absorber. Le problème, c’est qu’on manque de bras pour répondre à toutes les sollicitations. »
Le nerf de la guerre : le temps médical
Pour Omedys, l’obstacle principal reste l’accès au « temps médical », c’est-à-dire la disponibilité réelle de médecins. « Les médecins sont concentrés en milieu urbain. Les zones rurales, qui en auraient le plus besoin, sont les grandes oubliées. » Pour répondre à la demande, Omedys intéresse des profils variés : jeunes praticiens pas encore installés, médecins proches de la retraite ou retraités désireux de maintenir une activité, ou encore généralistes cherchant à diversifier leur quotidien. « On leur propose un modèle attractif, simple, sans contraintes administratives. Et surtout, on leur donne du sens : contribuer à la lutte contre les déserts médicaux, sans devoir s’y installer. » Et ça fonctionne. À Troyes, par exemple, 16 médecins participent à l’aventure, dans une ville qui n’a pourtant pas d’hôpital universitaire. « Le turnover est très faible. Une fois qu’un médecin entre dans le dispositif, il reste. »
Un modèle humain, structuré et reproductible
Pour structurer le déploiement, Omedys s’appuie aussi sur une équipe d’« ambassadrices de télémédecine » dans chaque région. Ce sont souvent des infirmières, chargées de coordonner les projets localement « elles sont le lien avec les pharmaciens, les infirmiers libéraux, les professionnels de santé. C’est notre force de terrain. » L’entreprise compte aujourd’hui 22 collaborateurs, certains à temps partiel. Une organisation agile, adaptée à la diversité des territoires couverts. À ce jour, Omedys est présent dans le Grand Est, la Normandie, le Centre-Val de Loire, les Pays de la Loire, l’Occitanie, la Bourgogne-Franche-Comté et bientôt les Hauts-de-France. Des projets sont en cours dans le Rhône-Alpes, la Drôme, et l’Auvergne.
Redonner un suivi aux patients sans médecin traitant
Mais au fond, que fait concrètement Omedys ? « On s’adresse aux patients qui n’ont plus de médecin traitant. Et il y en a beaucoup plus qu’on ne le croit. L’Assurance Maladie sous-estime ce chiffre : on reste considéré comme “ayant un médecin traitant” jusqu’à deux ans après son départ à la retraite… » Omedys vient donc proposer une solution ponctuelle ou régulière, grâce à des consultations télé-médicales organisées dans des espaces adaptés, avec un professionnel de santé, tel une infirmière ou un pharmacien, pour accompagner le patient, qui échange avec le médecin en visio ou par téléphone. « Ce sont souvent les médecins eux-mêmes qui nous renvoient leurs patients en cas d’absence, de surcharge, ou de congés. » L’objectif n’est donc pas de substituer la télémédecine à la relation de proximité, mais de maintenir un suivi pour éviter les renoncements aux soins. « On travaille avec les médecins, pas à leur place. »
Une réponse à une crise structurelle
Pour Jérémie Goudour, la crise actuelle de l’accès aux soins est appelée à durer. « On peut supprimer le numerus clausus, augmenter les capacités de formation, élargir le champ de compétences des pharmaciens… mais ça ne suffira pas. Il faut aussi repenser l’organisation. » Dans d’autres pays, rappelle-t-il, le système de santé est davantage structuré autour de la délégation. « En France, on reste sur un modèle très centré sur le médecin. On doit évoluer. » Et Omedys pourrait être l’une des pièces de cette nouvelle organisation, à condition de garder le cap : « Ce modèle, il ne doit pas devenir un Uber de la médecine. Il doit rester centré sur l’impact social, la qualité des soins, la coopération. »
Une vision d’avenir pour la télémédecine
Le modèle Omedys séduit par sa cohérence et sa stabilité, ce qui attire des jeunes médecins motivés par la dimension solidaire du projet. « On voit que ça parle à une génération en quête de sens. » D’ici fin 2025, la société espère atteindre 15 cabinets médicaux. Mais l’objectif n’est pas tant la croissance que la consolidation : « Il faut que le modèle prenne racine. Ensuite, on pourra l’élargir à d’autres spécialités, développer de nouvelles synergies. » Une ambition lucide, au service d’un idéal simple : soigner là où c’est devenu difficile, sans renoncer à la qualité, ni à l’humain.
En direct des Caisses régionales
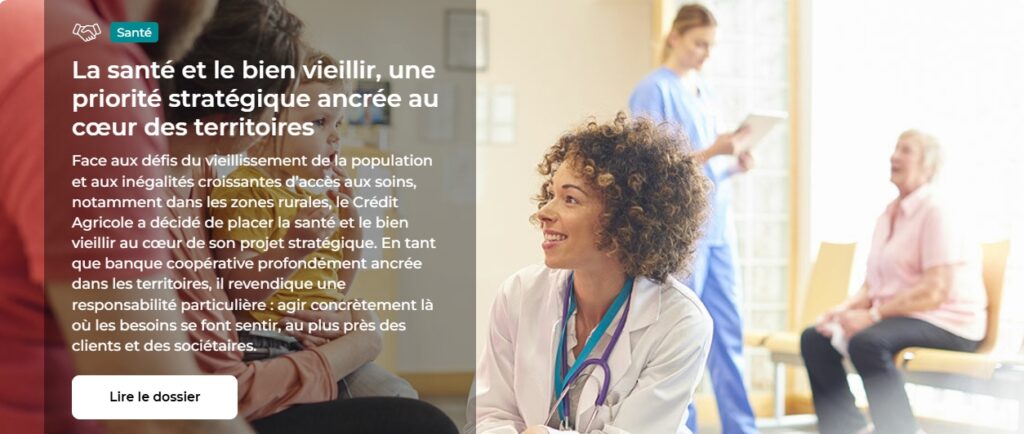
Instance politique du Crédit Agricole, la Fédération nationale du Crédit Agricole est une association loi 1901. Ses adhérents sont les Caisses régionales, représentées par leurs présidents et leurs directeurs généraux.
Mieux nous connaitre